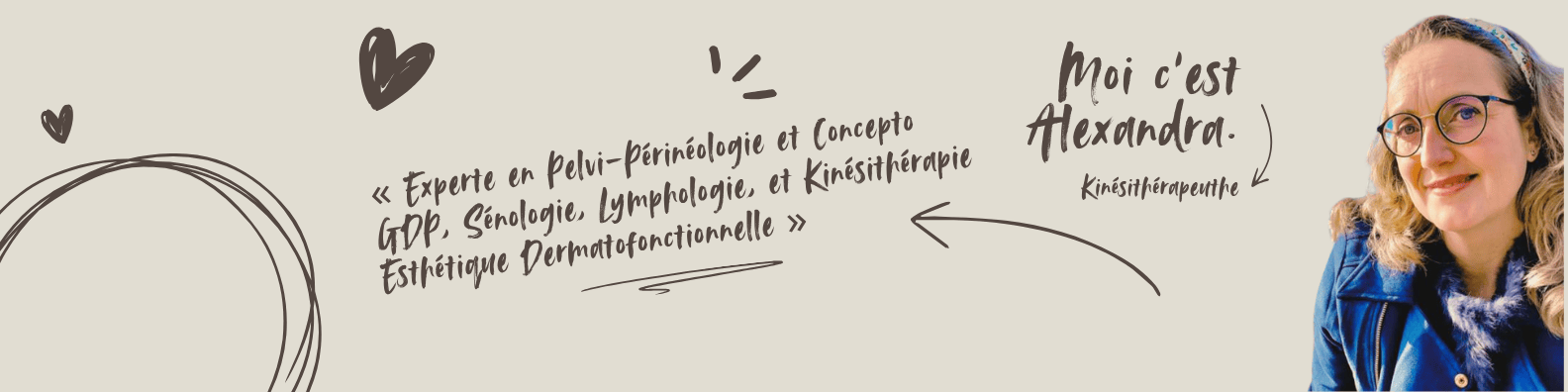L’éthique numérique ne doit pas être perçue comme une contrainte. Elle est une dynamique, une boussole qui oriente les choix technologiques vers un progrès respectueux de l’humain et de la société.
L’Éthique et le Numérique : Bâtir une Société Responsable et Inclusive
Dans un monde où le numérique redéfinit nos interactions et nos pratiques, la réflexion éthique devient essentielle. Les nouvelles technologies touchent des domaines aussi sensibles que la santé, où les enjeux de confidentialité, de partage et de sécurité des données à caractère personnel sont au cœur des préoccupations. La loi n°2022-1616, entrée en vigueur le 31 décembre 2023, marque un tournant décisif en imposant un cadre éthique renforcé pour les services numériques en santé, tel que défini dans l’article L1470-5 du Code de la Santé Publique.
Explorer les fondations de l’éthique numérique
Ouverture et introduction
- Jean-François Delfraissy, Président du CCNE, a retracé l’engagement historique du CCNE sur les questions éthiques liées au numérique, tout en rappelant l’importance de structurer ces réflexions à l’échelle nationale.
- Claude Kirchner, Directeur honoraire du CNPEN, a proposé un bilan des réflexions nationales sur l’éthique numérique entre 2010 et 2024. Il a souligné la nécessité d’une approche collaborative pour répondre aux défis sociétaux engendrés par les nouvelles technologies.
Garantir la sécurité et l’interopérabilité des données numériques de santé
L’article L1470-5 stipule que les services numériques de santé, destinés à gérer des données personnelles sensibles, doivent se conformer à des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique. Ces référentiels sont élaborés en concertation avec :
- Les professionnels de santé,
- Les associations d’usagers du système de santé,
- Les opérateurs publics et privés impliqués dans le développement des systèmes d’information en santé.
L’objectif est double :
- Protéger les droits des individus, notamment en garantissant la confidentialité des données de santé.
- Optimiser le partage et l’échange sécurisé des données pour améliorer l’efficience des systèmes de soins, notamment dans le cadre de la recherche clinique.
Ce cadre repose sur l’utilisation de standards ouverts, facilitant ainsi l’extraction et l’exploitation des données tout en respectant des normes éthiques strictes. La mise en œuvre de ces référentiels est supervisée par un groupement d’intérêt public (GIP), garantissant leur suivi et leur mise à jour régulière.
Une illustration des enjeux éthiques numériques en santé
La loi n°2022-1616 et ses dispositions montrent à quel point le numérique, loin d’être une simple opportunité technologique, pose des questions fondamentales :
- Comment concilier innovation et protection des droits ?
- Quel équilibre entre efficacité des systèmes et respect de la vie privée ?
Comme l’ont rappelé plusieurs intervenants lors de la journée d’échanges organisée par le CCNE, l’éthique dans le numérique, et plus particulièrement dans le secteur de la santé, doit reposer sur des principes clairs : transparence, responsabilité et inclusion.
Jean-François Delfraissy, Président du CCNE, a souligné que ce cadre ne doit pas être perçu comme une contrainte, mais comme une opportunité de construire des systèmes plus justes et plus efficaces. En intégrant toutes les parties prenantes – professionnels, citoyens et institutions – dans la création des référentiels, la France affirme sa volonté de placer l’humain au cœur de l’innovation.
Face aux transformations profondes qu’apportent les technologies numériques, une journée de réflexion orchestrée par le Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE) a permis à des experts de divers horizons de s’unir pour aborder des questions essentielles : que signifie intégrer l’éthique dans le numérique ? Et comment pouvons-nous, collectivement, façonner un futur plus juste et respectueux de nos valeurs ?
Cette rencontre a été bien plus qu’un simple partage d’idées. Elle a incarné un esprit d’ouverture et de coopération, réunissant scientifiques, philosophes, industriels, décideurs politiques et citoyens autour d’un objectif commun : repenser notre rapport au progrès technologique, non pas pour le freiner, mais pour mieux le guider.
Table ronde 1 : Éthique et numérique – De quoi parle-t-on ?
Cette session introductive s’est penchée sur les fondations de l’éthique numérique. Les intervenants ont exploré ce que signifie intégrer l’éthique dans un monde en constante évolution technologique, tout en rappelant que cette démarche dépasse le simple cadre normatif.
– Éric Germain, membre honoraire du CNPEN, a mis en lumière le rôle fondamental de l’anticipation éthique, où il ne s’agit pas seulement de réagir aux conséquences des technologies, mais d’intégrer les principes éthiques dès leur conception.
– Catherine Tessier, chercheuse à l’ONERA, a développé l’idée de l’éthique par conception (ethics by design), insistant sur l’importance pour les concepteurs d’outils numériques de traduire les principes éthiques en actions concrètes.
– Alexei Grinbaum, président du comité d’éthique du CEA, a abordé la manière dont l’innovation peut être orientée par des valeurs, tout en mettant en garde contre les dérives technologiques non contrôlées.
L’éthique numérique ne doit pas être perçue comme une contrainte. Elle est une dynamique, une boussole qui oriente les choix technologiques vers un progrès respectueux de l’humain et de la société.

Table ronde 2: Place et rôle des comités d’éthique en France
Cette table ronde s’est intéressée à la manière dont les comités d’éthique en France peuvent structurer et encadrer les réflexions sur le numérique.
– Bernard Nordlinger, président du Comité Éthique pour les Recherches en Santé, a mis en avant le rôle transversal des comités d’éthique dans la coordination des réflexions, particulièrement en santé, où les données numériques exigent une vigilance renforcée.
– Brigitte Séroussi, responsable de la cellule éthique de la délégation ministérielle à la santé numérique, a insisté sur l’importance d’un cadre éthique opérationnel pour garantir que les outils numériques respectent les principes de confidentialité et de sécurité.
– Jean-Luc Sauron, président du Comité Éthique de Viginum, a abordé la souveraineté numérique et la nécessité pour la France de maintenir une gouvernance nationale forte face aux acteurs internationaux.
Les comités d’éthique ont un rôle clé à jouer dans la régulation du numérique, mais leur efficacité dépendra de leur capacité à dialoguer entre eux et à construire une vision cohérente et adaptée aux spécificités de chaque secteur.

Table ronde 3 : Étique du numérique, débat sociétal et impacts sur la réglementation
Cette session a exploré les enjeux internationaux et les mécanismes de régulation.
– Lyse Langlois, directrice générale de l’OBVIA (Canada), a présenté l’approche canadienne, basée sur des consultations citoyennes et des codes de conduite volontaires, qui permettent d’aligner innovation et acceptabilité sociale.
– Michalis Kritikos, du Groupe Européen d’Éthique, a mis en avant les efforts européens, notamment l’AI Act, qui cherche à harmoniser les régulations tout en respectant les diversités culturelles des États membres.
– Konstantinos Karachalios, représentant de l’IEEE, a insisté sur l’importance de créer des cadres de collaboration internationale, rappelant que les technologies numériques transcendent les frontières et nécessitent une réponse globale.
L’éthique du numérique n’est pas seulement un enjeu national. C’est une question universelle qui exige une coopération internationale pour définir des normes communes et garantir une innovation responsable.

Table ronde 4 : Grands établissements scientifiques et éthique numérique
La dernière table ronde a mis en lumière le rôle des institutions scientifiques et académiques dans la promotion de l’éthique numérique.
– Antoine Petit, président du CNRS, a expliqué comment l’éthique est intégrée dans les recherches fondamentales, en encourageant les chercheurs à réfléchir aux implications sociales de leurs travaux.
– Didier Samuel, président de l’Inserm, a souligné l’importance de mettre en place des protocoles éthiques rigoureux, en particulier dans les projets impliquant des données de santé.
– Yassine Lakhnech, président du Conseil de Recherche de France Universités, a insisté sur la formation des nouvelles générations de chercheurs, pour que l’éthique devienne une compétence intégrée dès le début des carrières scientifiques.
Les grandes institutions doivent être exemplaires, non seulement dans la manière dont elles conduisent leurs recherches, mais aussi en formant des générations de scientifiques capables de conjuguer innovation et responsabilité.

Une mobilisation collective pour un numérique responsable
Ces quatre tables rondes ont permis de tracer un chemin pour l’éthique numérique : un chemin où les institutions, les chercheurs et les régulateurs prennent la responsabilité de guider les innovations technologiques dans un cadre éthique solide. Les citoyens, bien qu’impactés par ces choix, ne sont pas directement acteurs dans cette dynamique. Cependant, leur confiance dans les systèmes numériques dépendra de la transparence et de la responsabilité des acteurs impliqués.
L’éthique, dans ce contexte, n’est pas une limite : elle est une force, un outil pour construire un numérique au service de l’humanité et non l’inverse.